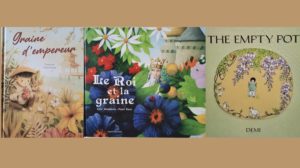Seulement 2 % des produits alimentaires consommés en Île-de-France sont locaux. Une réalité qui interpelle quand on sait que la région est par ailleurs une terre agricole qui exporte par exemple ses céréales. Pourrait-on dès lors remédier à cette situation ?
L’Île-de-France, région la plus riche du pays, concentre 30 % du PIB et une forte proportion de diplômés, tout en jouissant d’une réputation internationale. Cependant, elle est presque totalement dépendante de l’extérieur pour son alimentation, avec seulement 2 % des produits alimentaires provenant de la région selon une étude de 2017 et 5 à 7 jours d’autonomie en cas de crise.
Ces chiffres posent à la fois des questions de sécurité, de souveraineté et d’autosuffisance, et interrogent l’ensemble du système alimentaire, de la production à la consommation.
Du champ jusqu’à l’assiette, comment peut-on l’expliquer et comment, surtout, pourrait-on rendre l’Île-de-France plus autonome sur le plan alimentaire ?

Une autonomie alimentaire francilienne très faible
Commençons par un paradoxe : en Île-de-France, la production de céréales est très excédentaire par rapport aux besoins régionaux (3,2 millions de tonnes de blé en 2019, selon FranceAgriMer, qui, transformées en farine, représentent plus du double de la consommation de farine des 12 millions de Franciliens. Pourtant, le bassin de consommation importe de la farine, car une forte proportion de ce blé est exportée (70-80 %). Une étude précise le détail des 1,6 million de tonnes de nourriture venant de province qui entrent en Île-de-France chaque année : principalement des fruits et légumes, de l’épicerie, des boissons sans alcool et des produits laitiers. Elle nous permet également d’apprendre que les produits animaux, eux, ne satisfont qu’à peine 2 % de la consommation et que la production de fruits et légumes, correspond à moins de 10 % de la consommation régionale.
Pourtant, la région était maraîchère au moins jusqu’au début du XXe siècle. En 1895, l’Île-de-France était autonome, à près de 95 %, en fruits et légumes et, en 1960, on comptait encore plus de 20 000 ha de légumes diversifiés dans la région (environ 2 000 ha aujourd’hui).
Sur la partie la plus urbanisée, seuls 0,6 % des aliments consommés sont produits aujourd’hui dans la Métropole du Grand Paris (MGP), qui inclut Paris et 130 communes environnantes, et au moins 30 % des aliments consommés à Paris proviennent de l’international. Ce constat une fois posé, est-il envisageable aujourd’hui d’améliorer l’autonomie alimentaire de la Région ?

L’agriculture urbaine une voie d’autonomisation
L’agriculture urbaine est parfois présentée comme un moyen de conquérir de nouveaux terrains productifs en ville pour produire localement, en particulier des fruits et légumes. Cependant, les travaux de l’agroécologue Baptiste Grard montrent qu’en mettant en production la totalité des 80 hectares de toits cultivables à Paris, on fournirait au maximum 10 % des fruits et légumes consommés par les Parisiens.
De plus, la portance de ces toits et d’autres contraintes peuvent limiter la surface réellement cultivable. Malgré un soutien fort de la Mairie, la surface en production intramuros n’est passée que de 11 ha en 2014 à 31 ha en 2020.
Pour rendre l’Île-de-France plus autonome sur le plan alimentaire, il faudrait donc encourager les collectivités à utiliser davantage d’aliments issus de l’agriculture périurbaine.

La restauration collective : une voie d’autonomisation alimentaire et d’évolution de l’agriculture locale ?
Celle-ci paraît particulièrement bien indiquée pour alimenter la restauration collective, notamment publique (écoles, crèches, collèges, lycées, hôpitaux publics, Ehpad publics, prisons), qui représente en Île-de-France près de 650 millions de repas annuels servis, dont plus de 50 % en secteur scolaire. Elle constitue donc une source majeure d’influence sur l’alimentation des habitants et peut devenir un levier pour l’évolution de l’agriculture de proximité vers des formes plus durables, encouragées en cela par la loi Égalim.
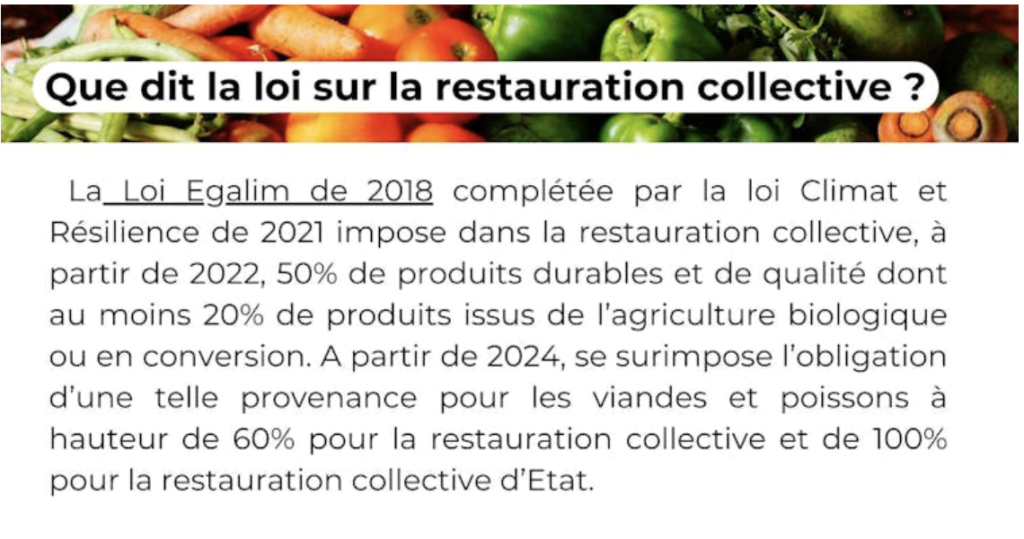
Le périurbain francilien, en Seine-et-Marne, Yvelines, Val-d’Oise et Essonne, participe de plus en plus à cette dynamique. On voit en effet croître le nombre d’exploitations diversifiant leurs productions vers des légumineuses et légumes de plein champ à destination de la restauration collective, notamment en production biologique, avec l’influence notable de la Coop bio d’Île-de-France, créée en 2014.
Il s’agit pour l’essentiel de céréaliers diversifiés ou de maraîchers d’assez grande taille (au moins une dizaine d’hectares) sur des espèces spécifiques (salades, carottes, pommes de terre…). Les plus petites exploitations maraîchères (moins de 5 ha), très diversifiées en légumes, dont beaucoup se sont installées ces dix dernières années avec un fort soutien des collectivités locales, sont moins orientées vers ce débouché, qui exige d’importants volumes à un prix relativement bas et induit beaucoup de contraintes de référencement pour les producteurs, d’où l’intérêt de formes mutualisées de commercialisation.
C’est ainsi que certaines collectivités préfèrent passer directement en régie agricole pour leur restauration collective à l’image de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) dans la Région Paca, ou de Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne) ou Villejuif (Val-de-Marne) en Île-de-France. La régie agricole est une ferme municipale dont le foncier appartient à la Ville et dont le personnel est salarié municipal.
Ce rôle structurant de la restauration collective a permis, en 2023, de lancer l’association AgriParis Seine, élargissant la notion de « local » à 250 km autour de Paris et visant à structurer des filières d’agriculture durable par l’achat public, en parcourant la Seine, du Havre jusqu’au nord de l’Yonne, le fleuve servant de voie majeure d’approvisionnement à terme. Dans le même temps, le schéma directeur de la Région Île-de-France envisage d’autres logiques, avec un projet de ceinture maraîchère autour de Paris.
Des formes d’agricultures urbaines inclusives et utiles pour des publics précaires
Soutenant, à travers la restauration collective, l’agriculture francilienne, les collectivités espèrent aussi lutter avec elle contre le fléau de la précarité alimentaire, qui s’est accrue ces dernières années : l’Agence nouvelle des solidarités actives la chiffre aujourd’hui dans une fourchette de 12 à 20 % de la population, avec de fortes disparités intrarégionales sur le nombre d’habitants touchés et l’intensité de cette précarité, qui va de pair avec une forte prévalence des maladies de la nutrition (diabète, obésité). L’agriculture urbaine (intra et périurbaine) peut-elle jouer des rôles intéressants pour mieux alimenter des personnes en précarité ?
Les jardins collectifs (familiaux, partagés, au bas d’immeuble), plus de 1 300 en Île-de-France en 2019, y contribuent directement par une autoproduction alimentaire, variable mais qui peut être non négligeable selon la taille des jardins et l’implication des jardiniers : elle pouvait représenter, en 2019, en jardins familiaux, plus de 1 500 € d’économie par an sur les achats de fruits et légumes d’une famille, et probablement plus aujourd’hui étant donné l’inflation. Avec l’augmentation de la pauvreté et la demande accrue de jardins collectifs depuis la crise Covid, il serait nécessaire de mener une étude sur les rôles quantitatifs et économiques, dans les territoires franciliens, des diverses formes de jardinage collectif.
En périurbain, les jardins d’insertion, dont ceux du réseau Cocagne, revendiquent plus de 140 000 paniers solidaires par an au niveau national. En Essonne, les jardins du Limon fournissent, eux, 550 paniers solidaires par semaine.
Le réseau des Amap d’Île-de-France (elles sont 290 en 2023) propose aussi, depuis 2021, des paniers solidaires ou des livraisons de surplus à des épiceries ou restaurants solidaires. Forme de solidarité éthique de base, cette fourniture reste cependant très confidentielle en termes quantitatifs.
De plus, la production d’aliments n’est pas tout, il faut pouvoir et savoir cuisiner les produits, ce qui n’est pas toujours possible (par absence d’équipements) lorsqu’on vit en hôtel social, en hébergement d’urgence ou dans d’autres logements précaires. C’est pour faciliter l’intégration de ces produits frais dans l’alimentation de publics en difficulté que des structures associatives combinent jardinage et transformation alimentaire.
L’importance de la démocratie alimentaire
À l’instar de la dynamique observée partout en France, se mettent en place en Île-de-France, des initiatives pour favoriser l’accessibilité à des produits de qualité pour toutes, s’appuyant sur des principes de « démocratie alimentaire » : expérimentations de caisse alimentaire locale, transferts monétaires « fléchés » vers des produits durables (Vit’Alim par Action contre la faim et le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis), comités locaux pour l’alimentation et la santé (PTCE Pays de France)…
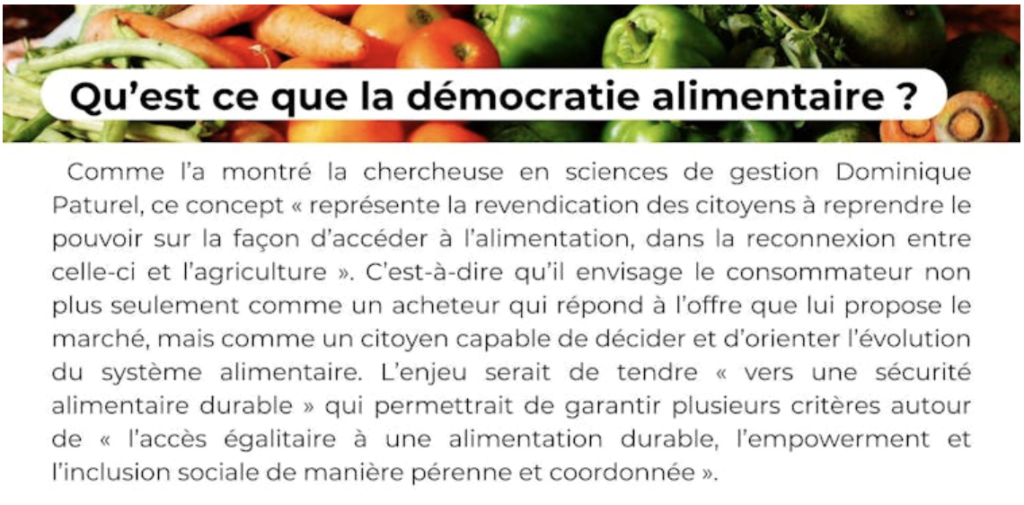
C’est un enjeu sérieux que de structurer l’analyse des retours d’expériences à en tirer, car de cela dépend la capacité de diffuser des modèles alternatifs proposés pour transformer le système alimentaire de façon pérenne. Le projet Territoire zéro précarité alimentaire (TZPA) (terme proposé par le Labo de l’ESS), mené par le réseau Agricultures urbaines et précarité alimentaire de la chaire Agricultures urbaines (Aupa), vise précisément à évaluer les impacts de plusieurs de ces initiatives sur la « sécurité alimentaire durable » dans les territoires concernés.
Il reste capital de pouvoir mieux évaluer scientifiquement, du point de vue de la lutte contre la précarité alimentaire, ces diverses initiatives, des Amapm aux régies agricoles, ce à quoi travaille la chaire Agricultures urbaines (AgroParis Tech).
En Île-de-France, l’autonomie alimentaire reste faible en raison des orientations actuelles des systèmes de production et des marchés.
Devenir plus autonome implique non seulement une production locale accrue, mais aussi la transformation et la distribution régionales des produits. La restauration collective et la lutte contre la précarité alimentaire sont deux leviers essentiels, souvent imbriqués ensemble : les collectivités signalent souvent que la restauration collective scolaire représente déjà une forme de lutte contre la précarité alimentaire des enfants, si toutefois les cantines scolaires sont bien accessibles à tous.
Ces deux sujets sont impactés par les politiques publiques et souvent limités par un manque de coordination et de moyens. Un meilleur soutien financier et une évaluation rigoureuse des initiatives locales pourraient inspirer des politiques publiques plus efficaces et durables. Là, la recherche en lien étroit avec les acteurs politiques et de terrain est fortement convoquée. Il va sans dire qu’elle aussi manque aujourd’hui de moyens pour cela.
Rédacteur Fetty Adler
Collaborateur Jo Ann
Auteurs
- Agnès Lelièvre
Maître de conférences en agronomie, AgroParisTech – Université Paris-Saclay.
2. Christine Aubry
Fondatrice de l’équipe de recherche INRAE « Agricultures urbaines », UMR Sadapt, AgroParisTech Université Paris-Saclay.
3. Clotilde Saurine
Animatrice de réseau sur le sujet de l’alimentation, AgroParisTech Université Paris-Saclay.
4. Doudja Saïdi-Kabeche
Enseignante Chercheuse en sciences de Gestion, AgroParisTech Université Paris-Saclay.
5. Fanny Provent
Ingénieure agronome.
Cet article est republié à partir du site The Conversation, sous licence Creative Commons
Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.